
Les caprices de Marianne
Infos & réservation
Thème
Coelio, un jeune homme bien né à l’âme noble et au lyrisme inspiré, est le soupirant transi mais constamment éconduit de la belle Marianne, toute jeune épouse de Claudio, riche juge criminel de la ville.
Mais Marianne n'a pas l’intention de répondre aux prières de cet inconnu qui ne lui a jamais adressé la parole. Incapable de parler pour lui-même et ne sachant plus que faire, Coelio confie sa cause à son ami Octave, libertin joyeux, amoureux du vin et de la débauche, et le charge d’aller parler pour lui à Marianne.
Redoutant un coup du sort, il lui fait promettre de ne pas le trahir ce que, bien malgré lui et malgré toute sa bonne foi et son amitié, Octave ne pourra éviter. Car le seul cœur tout à fait pur de cette intrigue - et par là même toujours menacé par le ridicule - est voué par son âme sublime au trépas.
Points forts
Le texte mobilise toute la finesse romantique pour interroger la singularité de l’amour et ce qu’il fait aux individus selon ce qu’ils sont, mais aussi selon qu’ils l’acceptent ou le refusent. • La situation de départ – celle de l’amoureux entiché d’une femme qui n’est pas libre - convention théâtrale classique est ici joliment grippée par la timidité d’un amoureux incapable de plaider sa cause, difficulté qui sera admirablement exploitée à la fin du siècle par Rostand.
Le romantisme n’empêche nullement le texte d’être parfois drôle et de proposer tambour battant, grâce à une mise en scène dynamique, des dialogues vifs et ciselés, notamment ceux de Marianne et Octave puis d’Octave et Claudia à l’acte 2.
L’interprétation remarquable de Zoé Adjani et de Philippe Calvario rend grâce à l’ambivalence et à l’ambiguïté du texte de Musset.
Quelques réserves
La première scène se déroule dans un décor assez élaboré, mais plutôt sombre et triste. Le principe des blocs montés sur roulettes et déplacés au gré des changements de scènes impose ici des emboitements exigus qui confinent les comédiens dans des espaces réduits, les obligeant à d’épuisantes acrobaties comme à d’heureuses sorties de scène.
Le dispositif s’allège ensuite, sans toutefois donner assez d’espace, excepté dans une dernière scène enfin ouverte, mais noyée dans une brume traversée de lumière sans doute excessive.
Les costumes qui ménagent une hybridation entre le XIXe siècle et aujourd’hui sont un peu étranges, mais assurent le lien avec le présent.
Encore un mot...
Mêlant amours contrariées et passion fulgurante et destructrice, ce drame qui ressemble à une tragédie - tant la circulation erratique du désir y est cruelle - témoigne du mal du siècle et de la difficulté pour les cœurs purs de survivre en ce monde bouleversé du XIXe siècle.
Véritable ode à la passion en même temps qu’invitation à la mesure, la pièce est aussi un vrai plaidoyer pour l’autonomie des femmes. Certes, le portrait de Marianne que dressent ses compagnons de scène est d’abord tout en convenances : épouse qui ne voit personne et ne sort de chez elle que pour aller à la messe, elle est « orgueilleuse et dévote » - « un trésor de pureté » pour les uns, un « dragon de vertu » pour les autres - ainsi qu’il sied aux femmes de son rang. Elle semble être aimée pour sa seule beauté, capital bien réel des jeunes filles à marier au XIXe siècle.
Mais Marianne est aussi bien plus que ce stéréotype, et l’intrigue révèle bientôt toute la profondeur et l’intelligence d’une femme qui n’accepte de dire à son mari que ce qu’elle juge utile au règlement de l’affaire avant de lui tenir tête résolument, réclamant pour elle la liberté de parler à son cousin « sous la tonnelle d’un cabaret », jouant de la raillerie et de l’ironie, décidant de prendre un amant par « un petit caprice de colère » ! Ce faisant, elle dénonce le sort fait aux femmes « aimées », prises entre assignations contradictoires et hypocrisies sociales : sommées d’aimer en retour sous peine d’être blâmées pour leur froideur comme elles sont sommées de demeurer vertueuses et fidèles par ceux qui les ayant épousées s’en croient propriétaires. La scène 1 de l’acte 2 offre un bien joli moment d’éloquence critique sur la condition féminine et l’impossibilité pour les femmes de répondre aux attentes paradoxales des hommes.
Une phrase
Coelio : « Que tu es heureux d’être fou !
Octave : Que tu es fou de n’être pas heureux ! »Octave : « Vous ne pouvez ni aimer, ni haïr, vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne, sans épines et sans parfum. »
Marianne : « Qu’est-ce donc après tout qu’une femme ? L’occupation d’un moment, une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée, qu’on porte à ses lèvres et qu’on jette par-dessus son épaule. Une femme ? C’est une partie de plaisir ! »
L'auteur
Cette « comédie » en deux actes, ainsi que la qualifiait Musset, qui soulignait ainsi la part de jeu qui habite les actions des protagonistes, est publiée en 1833 dans la Revue des deux Mondes, Musset a alors 23 ans.
La pièce est créée à la Comédie française le 14 juin 1851, ayant subi des modifications importantes exigées par la censure. Coelio et Octave sont un peu les deux visages d’Alfred de Musset, à la fois dandy romantique marqué par sa ses relations avec George Sand qu’il rencontre cette même année, mais aussi le dramaturge mélancolique et alcoolique qui écrira des pièces de commande pour Louis Napoléon Bonaparte, avec à la clef une entrée à l’Académie française en 1852.
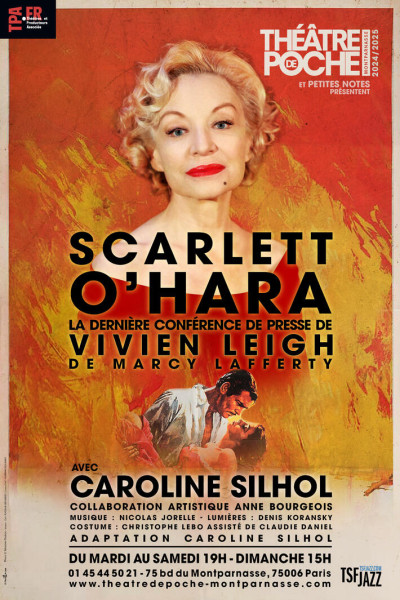

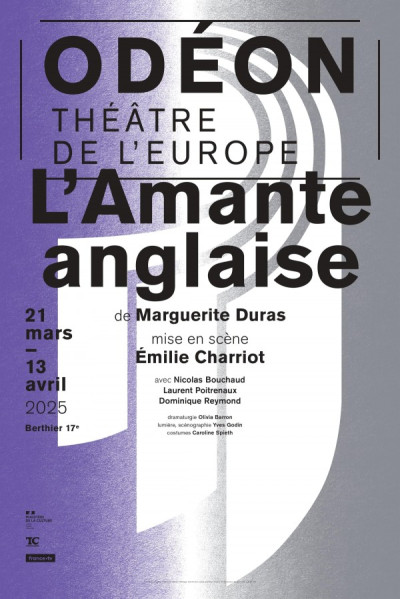

Ajouter un commentaire