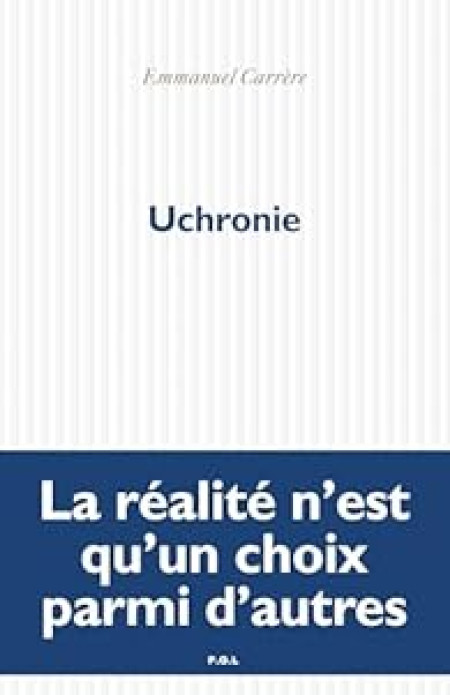
Uchronie
Parution le 6 février 2024
320 pages
22,50 €
Infos & réservation
Thème
L’uchronie se distingue de l’utopie sans s’y opposer, le « ou » grec, préfixe privatif étant respectivement associé à « chronos » pour « le temps » et à « topos » pour « le lieu », pour exprimer dans les deux cas une inexistence, l’uchroniste décrivant ce qui n’est « dans aucun temps » et l’utopiste, ce qui n’est « dans aucun lieu ».
Il est donc ici question de ce mot barbare et de l’idée confuse qui en constitue le soutien, inventé par le philosophe français Charles Renouvier à la fin du XIXème siècle et consistant en substance à réécrire l’Histoire à partir d’un fait réel ou d’une somme de faits réels, sans la travestir à la manière d’Ernest Lavisse dans l’esprit inspirant notre « roman national » et hors le champ politique du révisionnisme, mais pour donner un prolongement imaginaire, voire romantique, à des faits réels ; et ainsi faire de la réalité ce qu’elle aurait pu être, voire ce qu’elle aurait dû être, d’un point de vue personnel si l’on privilégie une fin sur une autre, d’un point de vue plus objectif si l’on considère simplement que la réalisation de certains évènements historiques décisifs procède de l’improbable, voire du cas fortuit.
Ainsi sera-t-il question, pour illustrer le propos, de la victoire de Napoléon 1er à Waterloo imaginée par un anglais, Douglas Hervey, une victoire résultant d’une information erronée donnée à Wellington sur la position de l’ennemi, ou de l’arrestation de l’empereur à Moscou en 1812, lui épargnant la retraite et la Bérézina ; encore et pour Jésus-Christ, de la relaxe de Ponce-Pilate, hésitant et pusillanime, la dispense de peine balayant la mort du Christ et donc la Résurrection et avec elles, l’idée même du christianisme, et par projection les croisades et les guerres de religion, l’Inquisition et les crimes commis en son nom. Jusqu’à cette conférence de Potsdam imaginée par un certain Randolph Robban, substituée à celle de Yalta où Hitler, Mussolini et Hiro-Hito se partagent le monde quand Truman, Churchill et de Gaulle comparaissent à Nuremberg …
Points forts
L’intelligence du propos qui embrasse tout, dissèque à l’envi la situation décrite et la manière de l’appréhender, d’en définir l’importance, la cause et la portée, en considérant par exemple qu’un événement isolé ou insignifiant sera d’une portée considérable, l’exemple de la relaxe du Christ en constituant la meilleure illustration si l’on considère le caractère très banal du procès, l’inexistence des crimes, la lassitude du Procurateur qui ne veut pas condamner le Galiléen qu’il prend pour un simple illuminé, et en contrepoint, la portée satellitaire de cette mort supposée ordinaire. Et à l’inverse, l’anéantissement de faits considérables qui n’infléchiront pas le cours de l’Histoire, ainsi la négation de la prise de la Bastille qui serait sans doute restée sans incidence sur l’avènement de la Révolution française.
La portée philosophique du propos qui renvoie à la définition du réel, à l’examen de la relativité et à la part de l’imaginaire dans la construction de la mémoire individuelle et collective, du déterminisme et du libre-arbitre.
Quelques réserves
Un doute sérieux, la dernière page tournée, sur l’intérêt réel du livre, petit précis de philosophie abscons quand on aurait sans doute préféré un florilège de ces uchronies plus qu’une introspection cérébrale assez confuse, sinon pour l’auteur qui semble très éclairé dans sa démonstration, du moins pour le lecteur qui s’y accroche de manière désespérée, comme un naufragé qui va boire la dernière tasse...
Le cantonnement un peu étroit à l’œuvre de Charles Renouvier et de Roger Caillois quand un petit saut dans la littérature plus contemporaine aurait été bienvenue, ainsi celle d’Eric-Emmanuel Schmitt avec la Part de l’autre, l’air pur et romanesque venant néanmoins de l’opportune évocation du magnifique roman de Blondin, Les enfants du Bon Dieu paru en 1952 qui met en scène un uchroniste qui s’ignore, un professeur d’histoire lassé de raconter la même Histoire de France à ses élèves d’une année sur l’autre et qui s’encourage à la travestir tous les ans un peu plus.
Encore un mot...
Emmanuel Carrère réédite aujourd’hui un ouvrage de jeunesse paru en 1986 sous le titre Le Détroit de Behring et prend opportunément le parti, en préambule, de rappeler qu’à cette époque, il n’était guère question d’uchronie, ni du mot d’invention récente et guère plus de l’idée, alors qu’aujourd’hui, le même mot envahit la toile avec plusieurs milliers de références. L’analyse de ce goût nouveau pour cette démarche intellectuelle consistant à gommer un épisode de l’Histoire ou à le transformer pour espérer réduire à néant ce qu’il a impliqué eut sans doute présenté un intérêt renouvelé, en même temps qu’il aurait posé une question sur les motivations négationnistes et révisionnistes de notre époque.
L’auteur pose un postulat d’emblée, l’uchroniste n’est pas un rêveur romantique, il ne cherche pas à développer son champ imaginaire, il conteste le fait réel et va proposer une histoire contrefactuelle au service d’une cause. Quitte à reprendre ce récit de jeunesse, il eut été intéressant de l’édulcorer un peu pour le confort du lecteur et de le replacer dans le contexte du XXIème siècle qui conspue l’Histoire et ses repères fondamentaux, discrédite le passé pour en faire table rase avant de requérir bientôt l’autodafé de tous les livres.
Une phrase
“ Supprimer toute trace de la défaite de Waterloo est une ambition excessive, et dénonce la folie qui la nourrirait. À tout prendre, mieux vaudrait pour cela s’établir en Angleterre, où Waterloo est une victoire, et se défaire du sentiment exprimé par Alphonse Allais que toutes les rues anglaises, ou les gares, portent des noms de défaite.” Page 67
L'auteur
Emmanuel Carrère, diplômé de Sciences-Po, est le fils de l’historienne et académicienne Hélène Carrère d'Encausse. Critique de cinéma, il entreprend une carrière d’écrivain au début des années 80. Son vrai premier succès reste sans doute le récit de la vie de Jean-Claude Romand, un citoyen ordinaire qui va enchaîner les mensonges du plus petit au plus gros avant d’éliminer tous les siens, un livre qu’il intitulera L’Adversaire (1993) et qu’il aurait pu appeler aussi bien L’Engrenage. En 2011, il recevra le prix Renaudot pour sa biographie romancée de Limonov, un dissident russe qu’il a rencontré, comme Romand d’ailleurs. Auteur à succès de quelques cinq romans et d’une dizaine d’essais, outre d’innombrables contributions, il a reçu une bonne quinzaine de prix dont le Renaudot, le Femina et le Prix littéraire du Monde.
A lire ci-dessous les chroniques concernant 2 livres d’Emmanuel Carrère :
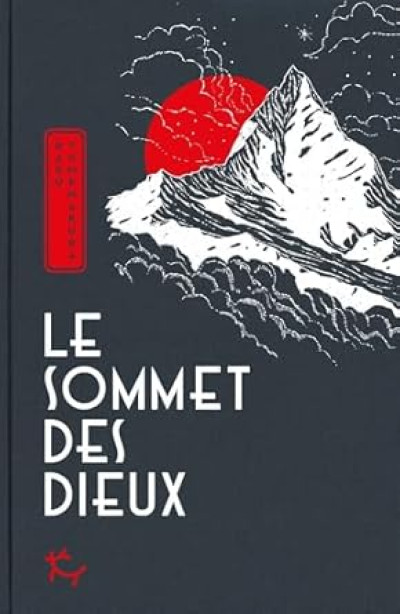
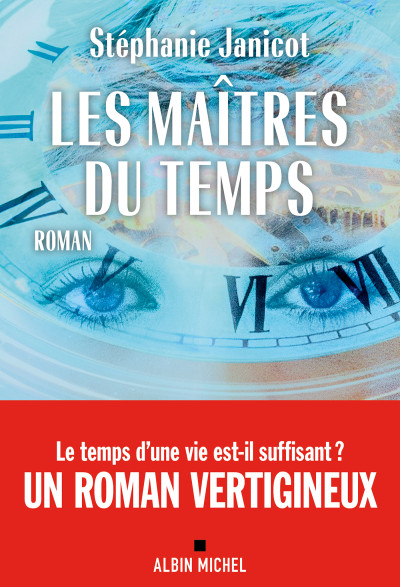
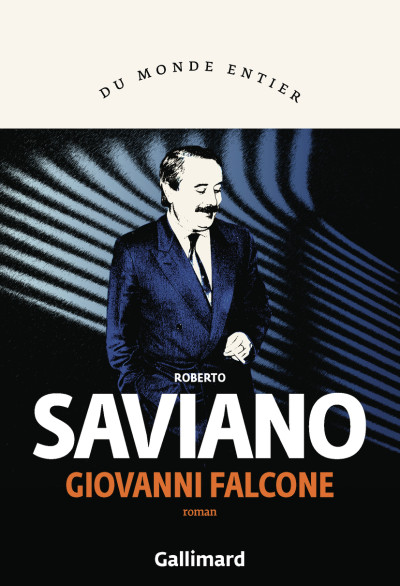
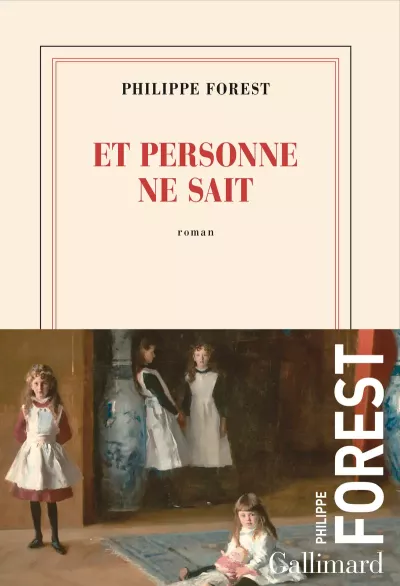
Ajouter un commentaire