
Au Printemps des monstres
750 pages
23 €
Infos & réservation
Thème
Le 26 mai 1964, le petit Luc Taron, 11 ans, fugue pour une raison qui demeurera mystérieuse. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ses parents ne se précipitent pas pour signaler sa disparition. Le lendemain, on retrouve l’enfant en banlieue, dans les bois - assassiné. Sans trace de lutte. Sans mobile apparent. Toute la France est en émoi. Qui est le monstre ? Un corbeau autobaptisé « L’Etrangleur » ne tarde pas à revendiquer le meurtre dans des messages effrayants adressés à la presse et aux parents… Jusqu’au moment où inexplicablement, comme un bleu, il se jette dans la gueule du loup lors d’un interrogatoire. La police tient son coupable : il s’appelle Lucien Léger, élève infirmier psychiatrique, pas de lien direct avec les Taron. Prison à perpétuité. Fin de l’histoire.
Pas pour Jaenada. Plus de cinquante ans après les faits, il rouvre le dossier Lucien Léger.
Points forts
Au printemps des monstres est un livre inclassable. Il y a évidemment les faits, la matière première explosive, « l’horreur de mourir à 11 ans », et l’enquête-puzzle que Jaenada reprend pièce par pièce, traquant les incohérences, soulevant chaque question restée dans le flou, profilant les différents acteurs de l’affaire. Pas le genre à suivre les pointillés. Dans cette autopsie, il pratique avec succès l’art d’impliquer le lecteur en lui faisant part de ses émotions – indignation, tristesse, compassion. Il a aussi sa façon bien à lui de rappeler qu’un écrivain est un corps en digressant sur ses pépins de santé, son corps en vrac au moment où il écrit, ou de laisser ses réflexions et ses déambulations l’emporter ailleurs. Sur les traces de Modiano, par exemple, cet autre explorateur du passé, dont la silhouette fantôme revient souvent errer dans le livre. Enfin, l'humour reconnaissable de l’écrivain et son autodérision sont une respiration dans la masse oppressante de cette affaire tragique.
Tout le livre s’efforce de cerner la personnalité de Lucien Léger alias L'Étrangleur. Alors qu’il encourait la peine de mort, l’homme s’est acharné à endosser le rôle du monstre, à enflammer les médias qui vont fondre sur ceux qui croient le connaître et tordre leur propos pour brosser de lui un portrait plus glaçant et pervers encore que l’hypothétique réalité. Pourquoi s’expose-t-il ainsi ? Pourquoi ment-il tout le temps ? Quelle est cette «loyauté » dont il se réclame sans cesse pour ne pas révéler la vérité vraie ? Un type apparemment banal devient une énigme humaine fascinante.
Rouvrir un dossier, c’est entrer dans une forêt profonde et sombre ; or Jaenada annonce dès son prologue qu’il n’aime pas les forêts parce qu’on n’y perçoit aucun signe d’humanité. Et en effet, en progressant dans la lecture d’Au Printemps des monstres, on s’aperçoit qu’elle a drôlement manqué d’humanité, cette affaire. Elle ne sent pas bon la forêt de la France des années 60. Elle dégage une odeur de meublés misérables, de parents cousus de secrets, de faux amis, d’une presse dite populaire qui se développe comme une tumeur et forge l’opinion, prédisposée à la curée. Dans les hautes sphères, ça vaut à peine mieux : le ténor du barreau censé défendre Léger n’a pas mis le nez dans le dossier et finira par laisser tomber son client. On passe sous silence des incohérences évidentes, des pistes qui s’écartent de la culpabilité de Lucien Léger qui sont négligées, comme celle de « l’homme en bleu » pourtant vu à la sortie du bois à l’heure du crime. Ils sont peu nombreux, les hommes de bonne volonté, ceux qui ont manifestement bien fait leur travail et seule une femme s’élève au-dessus de tous ces monstres. On découvrira laquelle.
Quelques réserves
700 pages, c’est long, lourd à transporter (sourire) et forcément un peu répétitif. Parfois, on se dit aussi que malgré toute sa rigueur Jaenada plie (un peu) les faits à son intime conviction.
Encore un mot...
Philippe Jaenada est un écrivain touchant et même miséricordieux. «Derrière les quelques secondes d’inhumanité d’un crime, il y a des vies », confie-t-il au journal Sud Ouest. Et d’ajouter ailleurs : « J’ai besoin d’empathie, de proximité, jamais je n’écrirais sur un serial killer. » De 19 kg de paperasse désincarnée, il réussit à exhumer un être humain, un présumé criminel qu’il faut essayer de comprendre (ce qui ne veut pas dire béatifier). “Frères humains qui après nous vivez, n’ayez contre nous le cœur endurci” pourrait être la devise de cet écrivain exigeant et de citoyen impliqué. Passionnant et plein de dignité.
Une phrase
L’enlèvement et la mort de Luc Taron, aussi triste à dire que ce soit, n’est qu’un fait divers (…). Ce qui peut se regarder, ce sont les gens qui gravitent autour de cette sauvagerie (…), le monde autour duquel un enfant a été trouvé mort au pied d’un arbre, seul la nuit dans une forêt. Ce qui peut se regarder, c’est ce qui entoure la forêt, c’est la justice, les médias, les avocats, la foule (…), les cachotteries partout, les bassesses, les infamies occultées, maquillées qui cernent l’infamie bien visibl.
L'auteur
Alors qu’il termine sa 2e année d’études scientifiques, Jaenada se rend compte qu’il se fourvoie. Pour autant, il ne sait pas encore ce qu’il veut faire ; du coup, il se cultive, explore divers boulots alimentaires : il anime les débuts du minitel rose, rédige des « gossips » pour Voici, traduit des romans sentimentaux, crée des tests pour des magazines féminins… Ce parcours éclectique et inattendu débouche sur une première publication : une nouvelle, dans L’Autre Journal en 1990. A partir de là, Jaenada enchaînera les livres et les prix – Prix de Flore en 97 (Le Chameau sauvage), Prix Femina en 2017 (La Serpe). D’abord autobiographiques, ses ouvrages se sont intéressés ces dernières années à la dissection de faits divers.
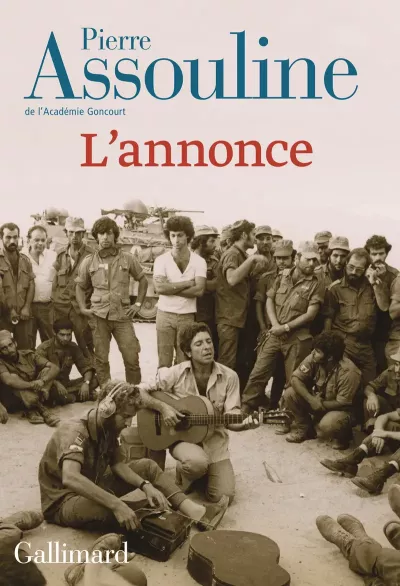
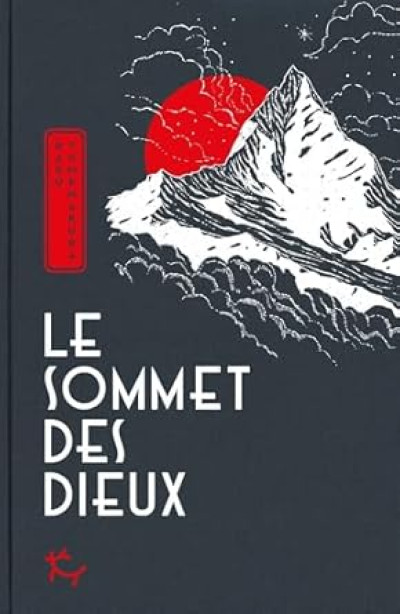

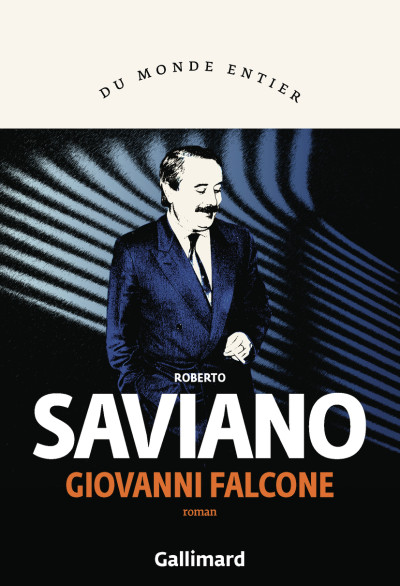
Ajouter un commentaire