
Venezuela
Infos & réservation
Thème
Créée à Tel Aviv en 2017 par le chorégraphe israélien Ohad Naharin pour la Batsheva Dance Company, Venezuela est une composition « miroir » : deux versions de la même chorégraphie sont présentées successivement, avec des distributions, des univers sonores et des atmosphères radicalement différentes. Tour à tour, une vingtaine de danseurs vêtus de noir déploie une série de tableaux vivants aussi virtuoses qu’éclectiques, au son de chants grégoriens, de textes de rap ou de musiques électroniques. Entre obscénité et majesté, la scène est envahie par un flot continu de mouvements, qui charrie avec lui une réflexion sur la singularité du geste incarné.
Points forts
La salle est encore éclairée, pleine de conversations animées, lorsque le rideau se lève et révèle un chœur de danseurs. Vêtus de noir (jeans pour les hommes, nuisette ou robe fendue pour les femmes) et dos au public, ils avancent lentement vers le fond d’une scène nue, délimitée par de simples panneaux sombres. La bande-son, composée par Maxim Waratt (pseudonyme d’Ohad Naharin lui-même), fait entendre les voix cristallines de chanteurs qui entonnent en grégorien un Kyrie, puis un Alma Redemptoris et une litanie des saints. Le contraste entre les deux ensembles s’accentue lorsque les danseurs s’engagent dans un mouvement impétueux, entre gestes brusques et languissants, voire léthargiques. Les élans des bras et des jambes sont brisés, contraints, frustrés, créant une atmosphère oppressante. A la tension qui règne dans le théâtre s’ajoute le bruit assourdissant d’une fréquence saturée, qui finit par l’emporter sur les chants religieux. L’un des danseurs pousse un cri de rage et un simple fondu au noir dissout la violence paroxystique de cette première partie.
Le second moment approfondit la réflexion sur l’herméneutique du mouvement. Reprenant les enchaînements précédents à l’identique, le chorégraphe fait entrer en scène un nouvel ensemble de danseurs et remplace les chants grégoriens par une bande-son hybride, composée entre autres de violons mélancoliques, d’une chanson hindi et d’un morceau de trap (courant de musique électronique). Dès lors, les versions symétriques de chaque tableau se télescopent. L’un des passages les plus troublants est celui qui réunit deux danseurs en avant-scène, autour d’un micro filaire, pour déclamer le titre du rappeur américain Notorious B.I.G. Dead wrong. Superposées aux chants grégoriens, les paroles évoquant des scènes de violences physiques, sexuelles et morales, résonnent immédiatement comme un blasphème. Mais reprises en seconde partie sur un instrumental moderne, leur agressivité et leur provocation interpellent sur la rage intérieure, en puissance dans chaque être humain. Ainsi également des bannières, dont le chœur vient recouvrir le corps d’un danseur étendu sur le sol. Dans la première partie, les tissus beiges évoquent des linceuls, tandis que dans la seconde, ils prennent les couleurs de drapeaux nationaux, comme si le monde entier écrasait de son poids le corps immobile. A travers ces déclinaisons de symboles, Ohad Naharin ouvre un champ de réflexion sur la perception et l’interprétation, sans prétendre orienter le regard.
L’étendue des styles maîtrisés par les artistes est impressionnante : entre danses latines, classique et contemporaine, les tableaux mêlent des pas de cha-cha-cha et de jive à des grands jetés, des arabesques et des mouvements désarticulés. Les pieds alternent entre position pointée et arc-boutée, tandis que les bras et les lignes du buste recherchent à la fois l’amplitude et le repli. Les corps semblent traversés par des forces qui les submergent : l’attraction du sol, qui les pousse à ramper, les pulsions animales ou l’atmosphère électrique, qui leur inspirent des mouvements syncopés et frénétiques. De même, Ohad Naharin explore l’occupation et la recomposition de l’espace scénique par les danseurs. Le chœur dense et harmonieux à l’ouverture du rideau se divise en duos, puis explose en une multiplicité d’électrons libres qui parcourent le plateau de façon désordonnée, se figeant parfois, avant de s’élancer de plus belle. Puis, les danseurs s’alignent et forment des vagues latérales, qui avancent et reculent en rythme, invitation irrésistible à sortir du rang en accélérant la cadence. Venezuela refuse l’unité et creuse sans cesse les contrastes.
Mais le plus frappant à travers les différents tableaux, c’est encore la puissance de l’engagement des danseurs dans le travail chorégraphique. Le rapprochement des corps se fait sur le mode animal, voire bestial, où l’autre est à la fois le « faible » mais aussi le « partenaire », le « complice » d’un pas de deux aussi bref qu’intense. Les regards des danseurs sont largement tournés vers le public, dans une attitude souvent accusatrice, provocatrice, mais aussi éperdue et implorante. Il faut alors souligner la spectacularité des solos, véritables partitions de virtuosité et d’expression personnelle des artistes. Grâce à l’effet de duplication de la chorégraphie, ces variations interrogent la singularité des corps dansants et l’énergie qu’ils dégagent dans leur mouvance. D’une version à l’autre, si les artistes semblent interchangeables, on distingue quelques différences dans les pas effectués, et surtout, une appropriation de la chorégraphie par chaque interprète. Ainsi se révèle, de façon saisissante, la dimension fondamentalement « incorporée » de la danse.
Quelques réserves
La singularité de cette création réside dans le moment pivot où les danseurs retrouvent leur position initiale et reprennent la chorégraphie sur une partition radicalement différente. De ce fait, les deux parties du spectacle présentent des déséquilibres, tant dans leur construction que dans leur réception. La première version de la chorégraphie a parfois du mal à capter l’attention de l’audience, car le déphasage complet entre le chant grégorien et la cadence imposée par les danseurs tend à diluer l’intensité du mouvement dansé. Pourtant, sans ce précédent, la seconde partie ne produirait pas un effet aussi spectaculaire. Quant à l’organisation des différents tableaux, elle semble parfois manquer de cohérence dans sa progression. Mis à part plusieurs fondus au noir, pour marquer le passage d’une formation chorégraphique (ou bande sonore) à une autre, les tableaux se juxtaposent plus qu’ils ne s’enchaînent et le fil narratif reste en partie obscur.
La frustration est également liée à la présence récurrente de lieux communs de la danse contemporaine. Au-delà des tenues sombres et austères, qui s’inspirent ici des costumes de scène de danses latines, la question de la domination et de la séduction charnelle se retrouve à nouveau au centre de la chorégraphie. Or, malgré la singularité des énergies émanant de chaque danseur, les propositions d’exploration du mouvement n’approfondissent pas véritablement le travail du chorégraphe israélien. S’agissant de la dimension conflictuelle qui caractérise la relation du groupe à l’individu, les tableaux de Venezuela reprennent des schémas dont l’efficacité a déjà été éprouvée : un danseur s’arrête tandis que le chœur continue son mouvement uniforme, un duo se transforme en solo puis s’associe à un nouveau partenaire, les danseuses se juchent sur le dos de leurs homologues masculins… Plus que visible, l’esthétique d’Ohad Naharin deviendrait presque prévisible.
Encore un mot...
Événement majeur pour la danse contemporaine cette saison, le passage de la Batsheva Dance Company au Théâtre National de la Danse - Chaillot met à l’honneur l’univers « gaga » d’Ohad Naharin. Avec Venezuela, le chorégraphe israélien exalte la singularité de ses danseurs en interrogeant l’irréductibilité des corps aux principes de symétrie et de répétition du mouvement.
Une illustration

Une phrase
« Pour un danseur, cette connaissance de ce qu’est notre corps et de ce qu’il ressent, cette conscience, est une des choses les plus importantes qui soient. Le corps peut d’ailleurs exprimer énormément d’excès ou de joie mais l’important est ce flux d’énergie qu’il ne faut surtout pas bloquer ou limiter. C’est une source qui peut nous guérir ». (Ohad Naharin, extrait de l’entretien avec Laure Adler, Hors-champs, 27 juillet 2016).
L'auteur
La collaboration entre la Batsheva Dance Company et Ohad Naharin commence à la fin du XXe siècle. La compagnie de répertoire est fondée en 1964 par la baronne française Bethsabée de Rothschild, sous le patronage artistique de Martha Graham. C’est cette dernière qui, en 1974, invite Ohad Naharin à la rejoindre comme danseur au sein de sa compagnie new-yorkaise. L’année suivante, Naharin complète sa formation en danse contemporaine dans de prestigieuses institutions américaines (Juilliard School et School of American Ballet), avant de rejoindre le Ballet du XXe siècle de Maurice Béjart à Bruxelles, le temps d’une saison. Dans les années 1980, il fait ses débuts en tant que chorégraphe et collabore avec plusieurs grandes compagnies internationales, dont le Nederlands Dans Theater et la Kibbutz Contemporary Dance Company. En 1990, il est nommé directeur artistique de la Batsheva Dance Company, désormais basée au Suzanne Dellal Centre de Tel Aviv. Sa première initiative est d’ouvrir une division junior, qui prend le nom de The Young Ensemble. A ce jour, il a créé plus de trente pièces pour les deux compagnies. En 2018, il quitte sa place de directeur artistique pour se consacrer à la chorégraphie et poursuivre le développement de la méthode « gaga », un langage corporel dont il est le fondateur, reposant sur une écoute profonde et consciente du corps et des sensations physiques. Ce style de danse est au cœur du travail quotidien de la Batsheva et s’est répandu dans le monde entier, adopté par des danseurs professionnels comme amateurs.
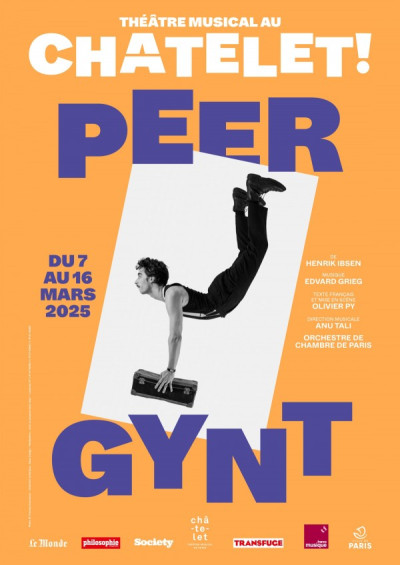



Ajouter un commentaire