
Don Carlos
Infos & réservation
Thème
Créé en français à Paris en 1867, d’après la tragédie éponyme de Schiller, Don Carlos est l’opéra le plus monumental de Verdi. Joué, comme ici, dans l’intégralité de ses cinq actes, il dure plus de quatre heures.
Son histoire se situe dans l’Espagne du XVIème siècle, écrasée sous le joug de l’Inquisition. Le roi Philippe II vient de monter sur le trône, mais sans le panache et la hauteur de vue de son père, Charles Quint. Pour faire la paix avec la France, il a consenti à ce que son fils, Don Carlos, épouse Elisabeth de France, la fille de Henri II. Les deux jeunes gens se rencontrent et tombent amoureux.
Mais, par une étrange et injuste volte face, Philippe II décide d’épouser lui-même la belle Elisabeth. La tragédie est en place, qui va s’amplifier par l’intrusion de la politique et des jeux de pouvoir dans cette affaire de cœur.
Passionnelles, religieuses, politiques…Des batailles de tous ordres vont faire rage. Carlos mourra; son meilleur ami, Posa aussi.
Sur scène, outre à un drame d’amour, on aura assisté, par un jeu d’arrière-plans, à un épisode terrible de l’Histoire d’Espagne, celui de la répression sanglante de la Flandre qui, attirée par le protestantisme, s’était révoltée contre son très catholique pays souverain.
Points forts
- L’œuvre d’abord. Pour cette fresque titanesque et spectaculaire, qui, sur fond d’intolérance religieuse, mêle raison d’Etat, dérèglements du cœur, amitié et trahisons en tous genres.
Verdi a composé une musique sans précédent dans son œuvre. Une musique certes, dans sa manière habituelle, riche, variée, somptueuse, mais ici, en plus, et pour la première fois, sombre, sépulcrale même, qui semble avant tout « dictée par le religieux », selon l’expression du chef Philippe Jordan. Quelle splendide et impressionnante partition !
- L’événement de ce Don Carlos est qu’il est donné en français, dans sa version initiale, montée très rarement pour des questions de durée. C’est d’ailleurs une version qui n’existe pratiquement pas en CD, puisque la plupart des chefs l’ont enregistrée en italien, amputée de son acte un.
- A production exceptionnelle, distribution sensationnelle. L’Opéra de Paris n’a pas lésiné, qui a convoqué sur son plateau les plus brillants interprètes du moment. Et d’abord, dans le rôle titre, le plus grand des ténors actuels, Jonas Kaufman. S’il se ménage un peu, sans doute à cause de ses récents problèmes de cordes vocales, le chanteur allemand reste d’une musicalité et d’une subtilité de jeu sans partage.
Face à lui, la soprano bulgare Sonya Yoncheva campe une superbe Elisabeth. Timbre somptueux, aigus magnifiques, elle met la salle à ses pieds, à l’instar d’ailleurs du français Ludovic Tézier. Il faut dire que dans son personnage de Posa, le baryton, projection impeccable, présence scénique forte et phrasé parfait, mérite tous les éloges. Avec sa belle ligne de chant, le Philippe II d’Ildar Abdrazakov prend aussi sa part de succès, tout comme la Princesse Eboli de la mezzo Elina Garanča dont la tessiture impressionnante n’a sans doute pas fini d’enthousiasmer les publics.
-Autre grand triomphateur de la soirée, le chef, Philippe Jourdan. Sa baguette, toute en souplesse, clarté, grâce, fluidité et précision tire le meilleur de l’orchestre, des chanteurs et des chœurs. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs directeurs musicaux actuels.
Quelques réserves
En ce qui concerne la mise en scène et la scénographie, quelle déception !
Dans un décor laid et glacial, de bois pour son fond et ses côtés, de métal pour la cage mobile qui va servir successivement de cachette, de prison et de salle d’escrime (On se demande pourquoi, ici, des escrimeuses !), le polonais Krzyztof Warlikowski a conçu une mise en scène sans audace, qui va sans cesse à contre sens de ce qui est écrit dans le livret. Et quelle froideur pour une œuvre aussi tumultueuse ! Sa vision n’est même pas transgressive, ce qui, au deuxième degré, aurait pu réjouir les amateurs, elle est seulement inexistante, vaine et triste. Sa direction des chanteurs suit le mouvement : elle est d’une platitude inimaginable, venant d’un metteur en scène qui méritait, il n’y a pas si longtemps, qu’on le porte aux nues.
Encore un mot...
Depuis que ce Don Carlos avait été programmé dans cette version française si rarement donnée, et avec cette distribution rassemblant le meilleur du chant lyrique, ce spectacle était annoncé comme un événement, non seulement français, mais international. Le patron de l’Opéra de Paris, Stéphane Lissner, peut respirer. Porté par des interprètes hors catégories, un orchestre au plus haut de sa somptuosité et aussi des chœurs au meilleur de leurs voix, ce spectacle comble, comme c’était attendu, les oreilles des mélomanes. Alors, au diable le décor et la mise en scène ! Pour atteindre le nirvana, il suffit de fermer les yeux et de se laisser porter.
Une phrase
« Drame politique mêlé à un drame amoureux sur fond de drame religieux, interrogation sur le pouvoir et la figure du père, l’intrigue de Don Carlos s'ouvre sur une dimension métaphysique inhabituelle tout en manipulant les codes, les thèmes et les scènes-types du genre : arrière-plan et personnages historiques, fastes de la représentation, fanatisme religieux…décors et costumes magnifiques où la réalité reconstituée dépasse le merveilleux » ( Hervé Lacombe, musicologue).
L'auteur
Né le 10 octobre 1810 à le Roncole (province de Parme) dans un milieu simple mais relativement aisé, Giuseppe Verdi est un musicien précoce. Il a tout juste onze ans quand on le nomme organiste de l’église de Busetto. Grâce à un négociant en spiritueux qui devient son mécène et dont il épousera plus tard la fille en première noce, il part approfondir ses études musicales à Milan. Il n’a pas vingt ans quand la Scala lui commande son premier opéra. Oberto lui vaut un succès qui l’encourage à persévérer dans le lyrique, pour lequel, d’ailleurs il n’arrêtera plus de composer, exception faite de la période qu’il lui fallut pour surmonter l’épreuve de la disparition de sa femme et de leurs deux enfants. En 1842, son Nabucco, d’une véhémence vocale sans précédent, connaît un triomphe. On en donnera 65 représentations, un record absolu dans l’histoire de la Scala.
Après Attila et Macbeth, il se retrouve sans rival. En 1851, Rigoletto qui sera le premier volet de ce qu’on appellera plus tard sa trilogie populaire (avec le Trouvère et la Traviata) assoiera encore sa notoriété, qui deviendra planétaire. Suivront , entre autres, Un Bal Masqué (1859), Don Carlos ( créé à Paris en 1867 ) , Aida (1871) et Falstaff ( 1893)..
Verdi, qui avait été élu député en1861, mourra à Milan le 27 janvier 1901, en léguant ses biens à la maison de retraite pour vieux musiciens qu’il avait fondé dans cette ville.
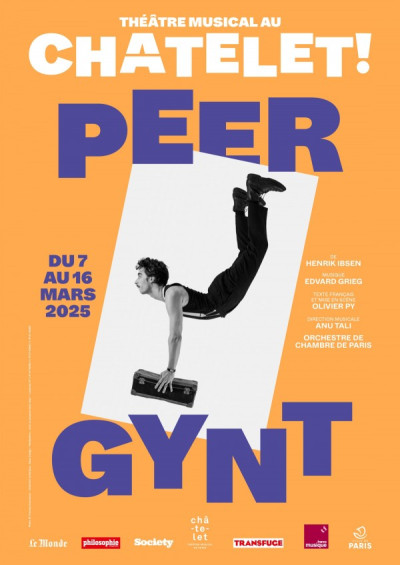



Commentaires
Quelle mauvaise critique ! Vous ne semblez pas avoir compris grand chose à la mise en scène de Warlikowski. J'étais à la première, et voici ce que j'ai écrit quelque jour après en réponse aux critiques de la presse - critiques imbéciles selon moi :
Mardi 10 octobre à l’opéra Bastille, la première de Don Carlos a reçu du public un accueil mitigé. Ovations pour les musiciens, chanteurs et instrumentistes compris, mais huées (couvrant quelques bravos quand même) pour la mise en scène de Krzysztov Warlikowski. Les critiques ont emboité le pas en décriant largement la mise en scène, à laquelle ils reprochent d’être trop sage. « Pas de sacre pour Don Carlos à l’Opéra Bastille » (Marie-Aude Roux pour Le Monde), « Scène banale, chant royal » (Philippe Venturini pour Les Echos), « Cherche Don Carlos désespérément » (Christian Merlin pour Le Figaro)... Seul Damien Dutilleul, pour Olyrix, rend hommage à l’ambition de la production avec son « Un Don Carlos superlatif à la Bastille ».
Qu’on permette à un amateur quelques remarques sur cette soirée, qui était annoncée comme d’anthologie et qui, selon certains, aurait fait un flop.
Tout commence par le décor. Oppressant, angoissant, austère voire lugubre. Dans cet Escorial marqueté de bois sombre, les hommes sont tout petits, perdus dans un cadre glacial. On est prévenu : le propos sera politique, et sévère. La transposition dans une Espagne moderne (costumes des années 1950) aux relents de franquisme, où les militaires galonnés voisinent avec les ecclésiastiques arrogants, est de ce point de vue très bien venue. Mais les critiques auraient voulu du mouvement, des cris, de l’obscène, du choquant, du sang, peut-être même du sexe ! Aguichés par l’affiche Warlikowski, connu pour ses excès, ils attendaient du scandale. Ils sont déçus par l’absence des décors hideux, façon terrain vague, qu’on met aujourd’hui à foison pour donner aux bourgeois le plaisir d’être de grands rebelles, et par la direction d’acteurs volontairement sobre et retenue. Cette fois, pas de maison de retraite ou de bordel gay. Alors ils parlent de « déjà vu » !
Même chose pour la direction des chanteurs, toute en intériorité douloureuse, en élans interrompus. Les mouvements sont rares, les acteurs paraissent entravés. Mais pour incarner un Carlos brisé, castré par un père abusif, qu’aurait-il fallu ? Un Heldentenor brillant ou un italien tonitruant ? Jonas Kaufmann peut faire cela ! Il peut crier « Esultate! » à pleins poumons ! Mais il est trop attentif au texte pour se faire plaisir en se poussant du collet là où il faut s’effacer. Il a l’humilité de tout faire pour incarner ses personnages, même si son égo de chanteur adulé doit en souffrir. C’est ce qui est magnifique dans son interprétation : avant tout celle d’un véritable acteur, sans concession pour la tentation de la gloriole bien facile chez le ténor chéri de ces dames. Quel courage faut-il, pour lui qui a déplacé 2500 personnes, pour se tenir en retrait, sans effets de manche ni de glotte ! Le plus important était de camper un antihéros faible et dominé, rongé par ses tendances suicidaires… il le fait en toute modestie. Un critique pousse le contresens jusqu’à regretter que Carlos ne soit pas plus jeune et plus exalté. Plus jeune, passe encore (quoique la flèche du temps est ainsi faite que ce reproche paraît bien vain, et bien injuste pour le meilleur ténor du moment). Mais « exalté » ! Mais « flamboyant » ! Quel ridicule, quelle honte, quelle catastrophe s’il l’avait été ! Merci à Kaufmann, en immense tragédien conscient de ses responsabilités dans une production qui a sa cohérence, d’avoir évité le piège d’un orgueil mal placé. Merci à lui d’avoir respecté la vision de Warlikowski, si sombre, si épurée, si vraie. Il ne claironnera pas pour plaire aux aficionados d’élans héroïco-lyriques. Mais il se rattrapera dans le duo final avec Élisabeth, chanté d’une voix si douce et si veloutée qu’on en a les larmes aux yeux.
Même chose pour Yoncheva/Élisabeth. Corsetée par les conventions, décidée à être à la hauteur d’un mariage qu’elle a accepté pour soulager la misère du peuple et non par inclination personnelle, Élisabeth ne peut jamais s’abandonner à son cœur. Elle bouge peu, paraît glacée. C’est ce qu’il faut, non ? Isolée, solitaire, surveillée à chaque instant dans une cour hostile où elle se sent étrangère, aurait-elle dû gambader pour créer un personnage « vivant » ? Elle finit d’ailleurs par s’empoisonner, et c’est très bien comme cela ! La beauté et la noblesse de son timbre sont entièrement au service de son personnage tiraillé entre l’amour et le devoir.
La seule qui doit être exubérante, c’est Eboli/Garança. Et elle l’est. En maîtresse d’arme toute de noir vêtue, dépassant d’une tête ses compagnes, elle a la carrure de l’ambitieuse, la dévoreuse d’hommes que dépeint le livret.
Ainsi, reprocher à la direction d’acteurs d’être figée est une erreur. À la cour d’Espagne, ou sous Franco, on imagine mal les gens faisant de grands gestes. La peinture que Warlikowski fait de l’oppression par le patriarcat (oppression familiale, oppression politique), sous l’égide d’une Église toute puissante, me semble au contraire très convaincante.
Les critiques ont encensé Ludovic Tézier (Rodrigue, marquis de Posa), pour sa prestance, son brio. Mais il a beau rôle d’être plus brillant que Kaufmann/Carlos ! C’est lui qui est idéaliste, entreprenant, politiquement engagé. C’est lui qui a un caractère entier, courageux, décidé. J’aurais même aimé qu’il pousse son interprétation plus loin qu’il ne l’a fait. Je l’aurais aimé plus manipulateur encore, plus double. Il est censé être le grand ami de Carlos, mais il l’utilise en fait pour servir sa propre cause politique. Carlos n’a rien d’un exalté politique. C’est Posa qui tente d’entraîner son faible ami dans son sillage – avec bien peu de succès, il est vrai. Il est plus politique qu’amical. Ainsi se comprend d’ailleurs qu’il accepte le rôle trouble de conseiller de Philippe, place qui ne peut que le mettre en porte à faux avec l’infant son ami. Beaucoup de mises en scène s’appesantissent sur les relations tendres entre Carlos et Rodrigue, certains y voyant même un amour homosexuel. Rien de tout cela chez Warlikowski. Dans sa vision, l’amour de Posa pour Carlos ne semble pas très chaleureux, et peut-être même pas très désintéressé. Pour souligner le côté manipulateur de Posa, Warlikowski a eu la bonne idée de le mettre à l’origine de la rencontre entre Carlos et Eboli, un malentendu de plus entre lui et son ami, et un désastre de plus pour Carlos. En définitive, les conseils de Posa auront les conséquences funestes que l’on sait. C’est parce que Posa a insisté pour que Carlos intercède en faveur des Flandres que l’infant défie Philippe – bien maladroitement – pendant la scène du couronnement. Tout cela aboutit à un échec lamentable. On peut entendre ainsi son « sacrifice » : au moment où il prend conscience de son échec politique, Carlos s’avérant incapable, malgré son influence, de se transformer en chef de la rébellion flamande, Rodrigue n’a plus qu’à mourir. Il le fait prétendument pour Carlos et surtout, mot révélateur, pour l’Espagne (que Carlos sauvé par lui pourra un jour diriger, avec un peu plus de sensibilité que son père, espère-t-il). Mais de toute façon, sauf à se transformer en un traitre avéré, ses jours auprès du roi étaient comptés. Avec ce point de vue, on comprend que Tézier/Posa ait pu se lâcher sur le plan vocal plus qu’un Kaufmann/Carlos empêtré dans ses souffrances morales.
Finalement, dans cette sombre méditation sur l’envers du pouvoir, il y a deux figures actives, passionnées, volontaristes : Posa et l’Inquisiteur. L’un et l’autre sont des vrais politiques. Ils luttent pour ce qu’ils croient être le bien. Pour Posa, le novateur, l’émancipation des Flandres ; pour l’Inquisiteur, le traditionaliste, l’ordre sous la direction inflexible de l’Église. En vrai homme de l’ombre, chacun tire les ficelles des dépositaires officiels du pouvoir, le roi Philippe II et l’infant Carlos, qui est appelé à succéder à son père. Entendu ainsi, Posa n’est pas moins manipulateur que l’Inquisiteur.
Comparés à ces deux personnages sûrs d’eux-mêmes (de leur cause comme de leur personne), Philippe et Carlos sont des êtres faibles, obsédés par leur amour malheureux pour Élisabeth. Ils ne sont pas « politiques » puisqu’ils ne pensent qu’à leur histoire de cœur. Chaque confrontation entre un prince et un conseiller aboutit donc à montrer la supériorité (de caractère) de l’homme de l’ombre : Carlos avec Posa (acte II, acte IV), Philippe avec Posa (acte II), Philippe avec l’Inquisiteur (acte IV). Le déséquilibre est sensible dans les duos. Rien d’étonnant alors que les critiques aient trouvé Tézier plus brillant que Kaufmann : c’est exactement ce qui est requis par le metteur en scène – et par le livret. De même Belosselskiy /l’Inquisiteur, homme de l’ombre plus qu’homme d’église (sobre costume gris d’homme d’affaire, petit col romain et croix minuscule au lieu des oripeaux habituels et de la pourpre cardinalice) écrase un peu Abdrazakov/Philippe (échevelé, en bras de chemise, tremblant devant l’Inquisiteur qui le contraint à cacher Garança/Eboli qui vient de s’offrir à lui et de lui livrer le coffret de la reine).
Chez les femmes, on trouve le même déséquilibre : l’une, la reine Elisabeth, est effacée, accablée par son mariage raté ; l’autre, la princesse Eboli, est pleine d’ambition, de désirs, d’action. Cela est particulièrement visible dans la scène du bal (acte III), où la reine épuisée abandonne sans lutter le champ à Eboli, qui s’en saisit avec avidité.
Don Carlos selon Warlikowski est donc bien une réflexion sur la faiblesse de ceux qu’on appelle « les puissants », manipulés et influencés par leurs prétendus inférieurs. C’est le pouvoir réel, officieux, qui prend le dessus sur le pouvoir officiel, cantonné à un état déclamatif, voire virtuel. L’un a la pompe, les symboles (l’immense manteau bordé d’hermine, la couronne…), l’autre la volonté, c’est-à-dire l’effectivité.
Dans le public, d’aucuns se sont plaints de l’effet « vieux film » utilisé dans certaines scènes. Il est vrai que cet effet vidéo est un peu fatiguant pour les yeux. Mais on s’y habitue vite. Dans l’acte de Fontainebleau, dans l’autodafé, il permet la séparation entre la scène officielle, telle que rapportée par les actualités cinématographiques, et la scène privée, l’envers du décor (ou plutôt, compte tenu de la configuration du plateau, son avant-scène). L’une glorieuse, l’autre triste, voire sordide. La vidéo permet aussi de clarifier les retours en arrière, réminiscences et souvenirs d’un Carlos obsédé par sa terrible histoire, notamment dans l’acte de Fontainebleau, qui est comme ajouté a posteriori – les amateurs de cinéma connaissent ce procédé du flash-back. Très bonne idée aussi que celle du prince déchu, relevant d’une tentative de suicide, qui découpe dans les magazines people les photos de celle qu’il a aimé, ruminant les étapes de la catastrophe !
Autre signe de mauvaise foi des critiques : certains se plaignent de ne pas comprendre chaque phrase du texte ! Mais quand on réunit un plateau aussi international, on ne peut pas avoir la clarté parfaite du français. Qu’on ait recours aux surtitres pour tout comprendre n’a rien d’étonnant, c’est le jeu de l’opéra. On ne peut pas avoir le beurre (les plus grands solistes internationaux) et l’argent du beurre (des locuteurs français irréprochables). D’ailleurs, mise à part Garança qui est vraiment très peu compréhensible, les autres solistes se tirent plutôt bien de l’exercice. Par ailleurs, le français donne un charme nouveau à cet opéra qu’on croyait connaître. Ce n’est pas seulement que Don Carlos est plus équilibré, plus compréhensible que Don Carlo, c’est aussi que le texte français nous sauve des rodomontades « à l’italienne ». On est ainsi davantage au théâtre, plus attentif à l’histoire, à la psychologie des personnages, à leurs souffrances et leur destin.
Ainsi Warlikowski prouve une fois encore qu’il est un grand metteur en scène. Il sait être là où on ne l’attend pas. Précédé d’un parfum de scandale, il révolutionne de ne pas révolutionner. Il refuse d’entrer dans la routine des mises en scène attendues, même quand cette routine repose sur la provocation. N’est-ce pas le fait des plus grands de savoir résister aux sirènes de leur propre réputation ? Et surtout, de savoir s’en tenir à l’œuvre, sans prétendre plaquer des schémas tous identiques sur des textes divers. Ce n’est pas parce qu’on a mis le feu à Iphigénie en Tauride qu’il faut traiter Don Carlos de la sorte. Chaque œuvre a son message, son style. Renouveler le sien propre est la tâche du metteur en scène. C’est ainsi qu’on peut servir au mieux et l’art, et le public.
Quant aux vedettes internationales qui ont mis de côté leur égo pour entrer dans ce jeu, qu’elles soient ici infiniment remerciées. C’est en conjuguant talent et modestie qu’elles resteront dans l’histoire, et non avec des fanfaronnades qui fatiguent les vrais amateurs plus qu’elles ne les séduisent.
Ajouter un commentaire