
Benvenuto Cellini
Infos & réservation
Thème
A Rome, au début du XVI° siècle, en pleine renaissance italienne, Benvenuto Cellini, sculpteur flamboyant, impulsif et bon vivant, est très ennuyé. Il a reçu du pape la commande urgente d’une monumentale statue de Persée, alors qu’il voulait profiter du carnaval - qui bat son plein dans la ville - pour enlever Téresa, la femme qu’il aime, et qui a été promise à un autre -sculpteur lui aussi mais d’un classicisme mortellement ennuyeux- par son père, le trésorier du pape…
Imbroglios, bagarres… Cellini, dans son emportement, tue le meilleur ami de son rival.
Pour obtenir l’absolution pour ce crime et, dans la foulée, la main de sa bien-aimée, il est contraint, par le Souverain Pontife, de lui livrer sa statue dans les meilleurs délais. Mettant en œuvre à la fois son ingéniosité et sa puissance de travail, Cellini viendra à bout du défi papal. Teresa sera à lui et la ville le portera en triomphe.
Points forts
Inspiré du roman autobiographique que le vrai Benvenuto Cellini, sculpteur et orfèvre aussi génial que rocambolesque, publia de son vivant, le livret de l’Opéra de Berlioz est un régal pour qui aime les œuvres « gargantuesques ». Le metteur en scène Terry Gilliam, l’un des plus « éruptifs » d’aujourd’hui, le « sale gosse » des Monthy Python, y a plaqué son goût pour le délire, la démesure et le burlesque! On n’est pas prêt d’oublier la scène d’ouverture, où, sous une pluie de confettis multicolores, il fait surgir, de toutes les entrées de la salle, une foule de monstres, d’acrobates, de jongleurs et de marionnettes géantes. Et tout ce petit monde joyeux, paillard et effervescent, de converger vers la scène par des passerelles sises à cour et à jardin, pour se fondre, après une réjouissante fiesta, dans d’époustouflants décors noir et blanc qui évoquent les gravures et dessins de Piranèse.
La scène de clôture restera en mémoire aussi, où tout un petit peuple, en liesse et en délire, célèbre Cellini au pied d’une gigantesque statue dorée, censée être celle de Persée. Les spectateurs sont, pour leur plus grande joie, noyés sous une averse de confettis, mordorés ceux-là, pour évoquer l’or de la statue.
Entre ces deux scènes, on aura écouté un opéra, certes, romantique, mais surtout ébouriffant, sans véritable ligne mélodique, qui s’autorise des arrières - plans orchestraux parfois déroutants, surtout dans l’acte 1, où l’orchestre a indéniablement le pouvoir, au détriment des chanteurs, qui doivent attendre l’acte 2 pour déployer l’étendue de leur talent.
Face à cette partition « cascadante », si périlleuse pour les voix, les chanteurs convoqués ici sont (presque) tous excellents, notamment le ténor américain John Osborn qui, dans un très bon français, compose un Cellini à la fois puissant, fougueux et en même temps déchiré entre son art et sa passion amoureuse. Remarquable, aussi, le baryton norvégien Audun Iversen qui interprète Fiéramosca son rival.
Sous la houlette de José Luis Basso, les chœurs flamboient, impeccables, se jouant avec une facilité déconcertante des difficultés phénoménales de la partition.
Dans la fosse, Philippe Jordan, élégant, rigoureux et précis comme à son habitude, parvient à faire entendre toutes les subtilités, toutes les audaces et toutes les folies de cette partition phénoménale. Il faut dire qu’il a, sous sa baguette, un des meilleurs orchestres d’Opéras du monde, celui de l’Opéra de Paris.
Quelques réserves
Dans cette production aussi spectaculaire que munificente, deux petits bémols:
- La voix de la soprano sud-africaine Pretty Yende n’a pas la force dramatique que requiert le rôle de Téresa. Elle a du mal à passer au dessus de l’orchestre, comme, d’ailleurs celle de la basse italienne Giacomo Balducci, qui interprète son père.
- On regrette aussi que le spectaculaire l’emporte parfois un peu trop (surtout dans l’acte 1) sur l’émotion.
Encore un mot...
Avant d’arriver à Paris, cette mise en scène signée Terry Gilliam était passée par Londres, où elle fut créée en 2014, puis Amsterdam, Barcelone et Rome. Partout, elle avait été ovationnée. Sans surprise, le soir de sa première à Paris, le public lui a réservé le même accueil…
Il faut dire que pour obtenir ce résultat, Terry Gilliam a mis le paquet. Dans ce Benvenuto Cellini, ce jeune metteur en scène de 78 ans a mis en vrac, son sens de la démesure, son humour, sa jovialité, sa sensualité joyeuse, son intelligence malicieuse, cela, sans oublier un seul instant, d’en diriger, d’une main ferme, les interprètes.
Si Berlioz avait eu un metteur en scène de cette trempe là lorsqu’il créa son opéra à Paris en 1838, il n’aurait sûrement pas été conspué comme il le fut.
Une phrase
« Berlioz le reconnaît lui même : sa musique a de grandes ailes ,que les murs d’un théâtre ne peuvent contenir. Benvenuto Cellini fit les frais de cette insolente liberté, en devenant une partition mal aimée. Quant à son compositeur, il se ferma définitivement les portes de l’Opéra de Paris pour le reste de ses jours. On ne mène pas sans risque une guerre contre l’art officiel : sans doute paya-t-il, pour avoir défié, de l’intérieur, le genre du Grand opéra » (Emmanuel Reibel, musicologue).
L'auteur
Né en 1803 à la Côte-Saint-André en Isère, Hector Berlioz aurait dû, comme son père, devenir médecin, s’il n’avait attrapé le virus de la musique à l’adolescence. Le bac en poche, il monte à Paris et fréquente l’Opéra beaucoup plus assidument que la faculté de médecine. Il entre d’ailleurs au Conservatoire de musique de Paris en 1826.
Ses compositions, dont en 1830, La Symphonie fantastique et en 1834, Harold en Italie lui vaudront l’admiration de musiciens comme Liszt, Paganini et Schumann.
Hélas, ces « parrainages » ne suffiront pas à lui épargner de cuisants échecs, dont, en 1838, celui de la création à Paris de ce Benvenuto Cellini.
Malgré tout, si son œuvre est considérée universelle aujourd’hui, c’est parce que ce compositeur audacieux et passionné n’aura cessé de puiser son inspiration chez les grands poètes et écrivains, comme Shakespeare, Virgile et Goethe.
C’est d’ailleurs le «Faust» de ce dernier (publié en 1808) qui lui inspirera, en 1846, «la Damnation de Faust», qu’il créera à l’Opéra Comique, en tenant lui même la baguette. Le demi-échec critique et public de cette création le laissera pratiquement ruiné, tant et si bien qu’il devra retourner à l’étranger pour y diriger, triomphalement, des concerts.
Rentré à Paris, il composera et créera de nouvelles œuvres, dont, en 1863, les «Troyens», dont il ne verra pas la représentation intégrale.
Affecté par la mort de sa femme, puis par celle de son fils, celui qui restera comme étant une des grandes figures de la musique romantique européenne, mourra, trop tôt, seul et malade, le 8 mars 1869.
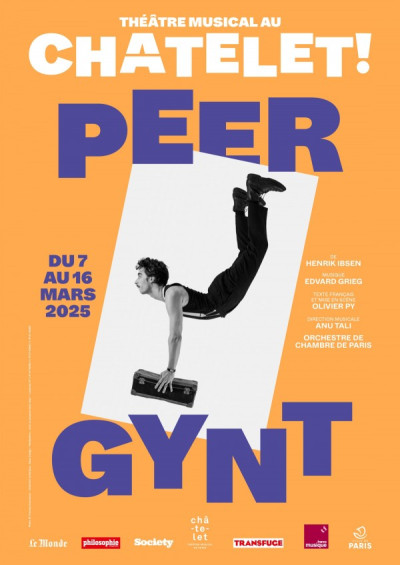



Ajouter un commentaire