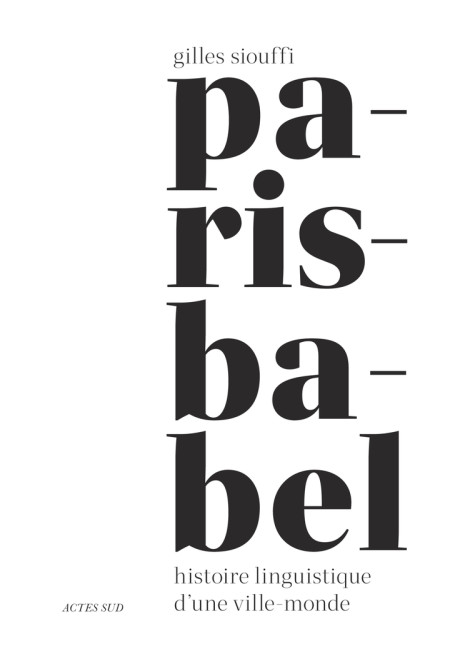
Paris-Babel
Parution en Janvier 2025
360 pages
25 €
Infos & réservation
Thème
L’histoire linguistique de la ville de Paris et de sa périphérie, des origines (la tribu gauloise des Parisii) aux parlers contemporains des banlieues (le verlan) en passant par les apports plus ou moins importants des populations venues s’agréger dans ce creuset en mouvement permanent (Romains, Francs, Vikings, Italiens, provinciaux de toutes langues et dialectes, natifs des Outre-mers…)
Points forts
C’est à une promenade bien agréable que nous convie Gilles Siouffi, dans laquelle on croise Villon, Molière et Victor Hugo, mais aussi Casque d’Or, Arletty ou Renaud… Cette véritable érudition universitaire commet l’exploit de n’être jamais pesante mais au contraire pleine de chaleur et d’humour. Personnellement l’auteur de cette chronique aura été sensible aux différentes déclinaisons du parler populaire parigot qui lui a rappelé quelques vieux souvenirs, lui qui a été le témoin de ses dernières manifestations chez ses camarades du service militaire !
Quelques réserves
Nous ne sommes pas en présence d’un texte littéraire, donc pas de style brillantissime ; pour autant l’usage d’une langue que certains pourront trouver plate n’est pas gênant, parce que le sujet est en lui-même l’intérêt de l’ouvrage. Gilles Siouffi, s’il n’est pas un écrivain au sens courant du terme, est un passeur, un vulgarisateur et son texte est sur le fond tellement riche qu’il en a banni le genre ennuyeux.
Une petite réserve, si l’on veut pinailler un peu, concerne le titre. Il est curieux – mais tout le monde agit ainsi – d’accoler le mot Babel à un lieu où coexistent de nombreuses langues et où, par conséquent, est censée exister l’incommunicabilité entre les hommes, conséquence de cette diversité. Or le mythe de la Tour de Babel est à l’origine exactement l’inverse, puisque, selon la Bible, les hommes de Babylone ne parlaient qu’une seule langue et ne formaient qu’un seul peuple ; c’est après la punition divine qu’ils se sont dispersés sur la surface de la Terre, formant des peuples étrangers ne pouvant communiquer entre eux et abandonnant donc la ville et le chantier de la tour. Ce changement de sens du récit initial serait intéressant à étudier lui aussi.
Encore un mot...
Voici un bel exemple de « gai savoir » qui nous fait apprendre une foule de choses sans même nous en rendre compte, épatés que nous sommes par l’origine de certains mots d’usage courant.
Amusant aussi l’éternel combat des puristes de tous les siècles, défenseurs autoproclamés de la langue « sérieuse » en lutte contre tous les patois régionaux et l’invasion des mots étrangers, en appelant au sursaut patriotique pour la préservation des usages et contre la corruption de la jeunesse. Non qu’il ne faille s’inquiéter de certains excès, et l’auteur évoque notamment l’utilisation frénétique de l’anglais sans grande raison valable à travers le globish et, au sein des entreprises, le langage corporate… Mais le français contemporain est plus que jamais une langue vivante qui s’enrichit d’emprunts variés qu’il ne faut pas rejeter par principe. Il est frappant à cet égard de constater que plus que d’autres pays, la France est à la fois le lieu d’une tentative étatique de conservation de la langue tant écrite qu’orale (l’Académie française créée par Richelieu) et d’une pratique populaire authentique qui fait constamment bouger les lignes avant d’être tardivement consacrée par les dictionnaires.
Cela semble être l’éternel conflit entre la Cour et la Ville, l’auteur montrant qu’au sein même de chaque entité des nuances existent, illustrées par Stendhal et Balzac en leur temps (les différences entre parlers « bourgeois » et « aristocratique », et dans le peuple selon les professions exercées).
Une phrase
- Le projet du livre est ainsi bien décrit :
« Au fil de cette histoire linguistique de Paris, c’est aussi une histoire de ses acteurs que l’on lira, célèbres ou anonymes. C’est à Paris que s’est inventée la notion de « peuple », et on a longtemps prêté au « peuple de Paris » toutes sortes d’usages parfois obscurs, du « jargon de l’argot » au javanais, avant que les banlieues ne répandent le verlan et le wesh wesh. Langues des chapitres médiévaux, des crieurs de rues du Moyen Âge, des escholiers rabelaisiens, des précieuses, des poissardes des halles, des clubs révolutionnaires, des gandins, des snobs, des dandys, des titis, des gavroches, des loubards, des marie-chantals, des branchés, des stylax : ce sont mille mots français qui se sont entendus dans Paris. Par ailleurs, capitale culturelle, « capitale des capitales » comme on a pu dire parfois au XIXème siècle, la ville a accueilli un nombre considérable d’étrangers non francophones qui l’ont enrichie, illustrée, fait rayonner, parfois dirigée. La France n’a-t-elle pas eu un rois béarnais, des reines italiennes ? Une Prix Nobel polonaise, des académiciens russes, argentins, libanais ? » (p. 13) - Et pour ceux et celles dont les oreilles auront été froissées lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, cette petite explication de texte :
« (…) la chanteuse malienne Aya Nakamura (Aya Danioko) (…) construit ses textes en associant de manière particulièrement dense verlan (laud-sa, tit-pe), abréviations (ya R pour « y a rien »), emprunts à l’anglais (je veux fly), à l’espagnol (que pasa), au nouchi ivoirien (djo ou boug pour « mec », tchouffer pour « merder »), au bambara (kouma pour « parler »), au romani (poucave pour « cafteur » devenu pookie), mais aussi de nouvelles expressions françaises (être dans son comportement pour « être bien dans sa peau »). Retrouver l’impression d’être dans une langue étrangère tout en restant « en français » : cela a été une inspiration constante de la chanson, notamment argotique, dans l’histoire. » (p. 319)
L'auteur
Gilles Siouffi est professeur en langue française à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Spécialiste d’histoire de la langue, particulièrement des XVIIe et XVIIIe siècles, il a travaillé sur l’imaginaire de la langue au XVIIe siècle, sur la constitution historique des normes en français, ainsi que sur la diversité des usages.
Il développe également une recherche sur le français contemporain, les attitudes à l’égard de la langue et la notion de sentiment linguistique.
Avant ce Paris-Babel plus spécialement consacré à la capitale, il a écrit des ouvrages dont le seul titre montre à la fois son ambition et sa passion pour ce thème : Mille ans de langue française, histoire d’une passion (2007) avec Frédéric Duval et le regretté Alain Rey, Le Génie de la langue française (2010) et plus récemment Une Histoire de la phrase française, des Serments de Strasbourg aux écritures numériques (2020).
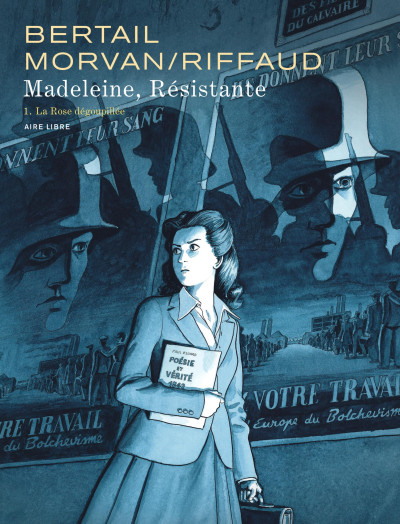
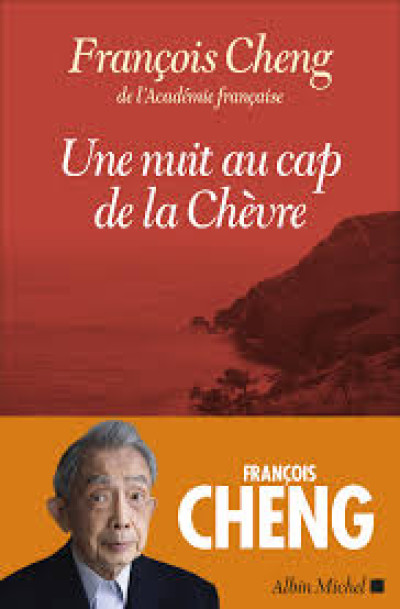
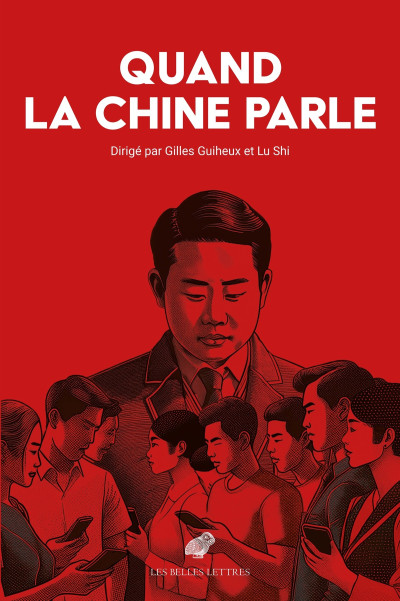
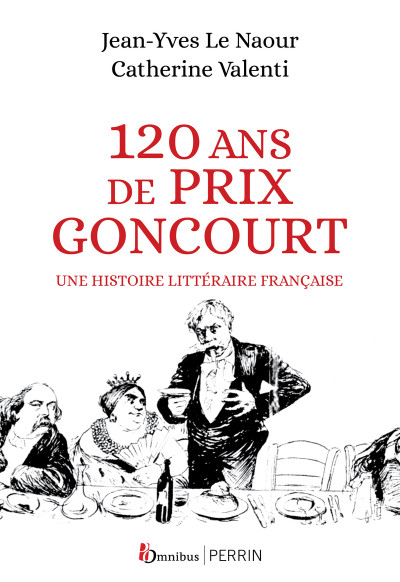
Ajouter un commentaire