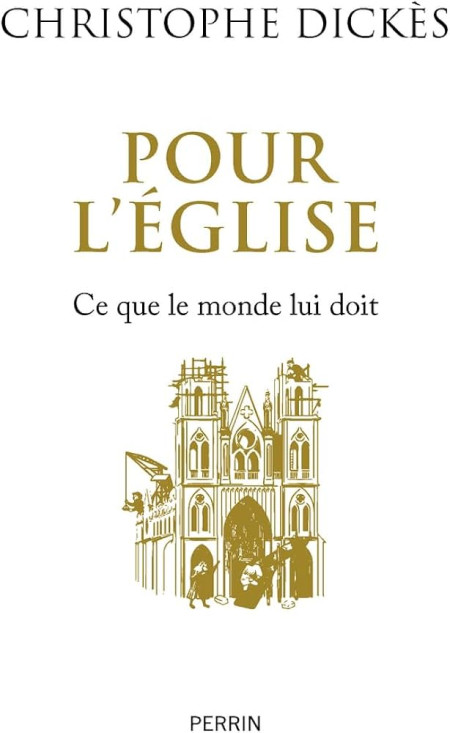
L'Eglise, ce que le monde lui doit
Parution en octobre 2024
270 pages
16€
Infos & réservation
Thème
Précisons d'emblée qu'il s'agit ici de l'Eglise catholique romaine. L'Eglise ? Dieu sait (c'est le cas de le dire...) si l'on peut lui adresser bien des reproches au regard de son Histoire (Croisades, Inquisition, condamnations etc.)... Christophe Dickès choisit, au contraire, de rappeler, en historien qu'il est, ce qu'elle a fait de bon pour le monde. Il prévient qu'il n'abordera pas l'apport artistique ni philosophique déjà largement traité par ailleurs. Il prend ici le parti (et le pari) de choisir de présenter les apports positifs en dix thèmes moins connus et même oubliés qu'il examine en trois parties subdivisées en chapitres.
Dans la première partie "Aux origines des sociétés", il rappelle que l'on doit à des hommes d'Église et le plus souvent à des moines (Denys le Petit, Bède le Vénérable, Wallingford...) d'avoir "mis de l'ordre dans le temps", réformé la manière de le compter, de le diviser, pour établir un nouveau et définitif calendrier. Ainsi, notre conception du temps aujourd'hui est-elle d'origine chrétienne. De même doit-on aux grands hommes d'Église des premiers siècles, pétris d'une double culture grecque et latine, d'avoir transmis l'héritage des civilisations antiques en même temps qu'ils diffusaient une nouvelle religion. Ecoles et Universités florissantes leur doivent vie. Puis, il aborde le point épineux d'une Église réputée opposée à la science, démontrant au contraire que bon nombre d'hommes d'Église étaient des scientifiques pointus. Et pour clore cette partie, il démontre dans le chapitre "Prendre soin", comment la religion chrétienne, se devant de pratiquer l'amour du prochain selon le message du Christ, est à l'origine des hôpitaux et des soins apportés aux plus nécessiteux.
La deuxième partie "Aux origines de la politique" examine les éléments de notre civilisation sous l'angle de l'organisation des sociétés : la démocratie n'est pas étrangère à l'Église. La distinction entre temporel et spirituel constitue l'un de ses principes essentiels. La question du legs chrétien de l'Europe est alors abordée et l'on sait le débat qu'elle a suscité : les données historiques fournies par Dickès aident à mieux positionner ce débat, de même que celui de la "guerre juste" qui, des Croisades à la conversion des Indiens, a tendance à nous faire juger du rôle et de la responsabilité des hommes d'Eglise avec un regard contemporain, ce qui est une forme d'anachronisme.
Enfin, la troisième partie "Aux origines de l'humanisme" permet à l'auteur de se pencher sur la position des femmes au sein d'une Église considérée comme misogyne, en rappelant le principe de l'égalité homme-femme et en soulignant le rôle qu'elles ont joué tout au long de l'Histoire, ainsi que sur la question de la liberté de conscience.
Points forts
L'introduction est brillante ! On peut la lire et même la relire ! L'auteur explique d'où vient la vision négative de l’Église, qui a été critiquée dès ses origines et tout au long des siècles (les critiques actuelles ne sont pas récentes), son histoire étant faite de conflits internes jusqu'à des ruptures (schisme, Réforme, anticléricalisme, etc). Il ne ferme pas les yeux sur les reproches adressés à l'Église, il ne nie en aucun cas ce qu'elle a pu faire de mal mais son objectif n'est pas de souligner les défauts et les manques mais bien au contraire "d'ajuster notre regard au sens propre, c'est à dire le rendre juste" : "Ce livre a pour objectif d'affirmer à tout le moins que les deux mille ans d'histoire de l'Église méritent la nuance". Et il ajoute : "Il est nécessaire de retrouver le sens de la complexité [de l'Histoire] et plus encore la manière dont des hommes d'Église ont contribué positivement à l'élaboration du monde dans lequel nous vivons".
Voici donc un ouvrage qui peut apprendre à peser le pour et le contre, à rendre plus objectif, à ne pas jeter l'anathème en oubliant des pans entiers de l'Histoire, bref à conserver à la fois lucidité et vérité.
Quelques réserves
Le titre interroge. Fallait-il écrire "Pour l'Église, ce que le monde lui doit" ou " Ce que le monde doit à la religion chrétienne" ou encore plus largement "à la civilisation chrétienne" ? Dickès fait un reproche virulent aux "hommes d'Église" qui, selon lui et quelques auteurs qu'il cite, manqueraient de culture historique. Ce serait l'une de leurs faiblesses. Qui épingle-t-il de cette manière ? Il existe aujourd'hui bien des prêtres passionnés d'Histoire, et de celle de leur Église évidemment, et plusieurs ont été ou sont des savants (épigraphistes, numismates, biblistes, déchiffreurs d'écritures disparues, etc. ...). Les fidèles catholiques ne trouvent pas non plus grâce à ses yeux : "Le plus étonnant, écrit-il, est qu'aussi bien les hommes d'Église que les catholiques n'ont plus conscience de ce qu'ils doivent à leurs prédécesseurs. S'ils sont familiers de la Bible, ils ignorent la longue et riche histoire de l' Église". On aurait envie d'ajouter : "la messe est dite" : l'Église et ses fidèles sont tous des ignorants en histoire ! Et il ajoute, pour enfoncer le clou : "La crise de l'Église contemporaine est pour partie liée à son ignorance du passé qui ne lui permet pas de comprendre le présent" (d'où le dernier chapitre de son livre qui s'intitule "Envoi, pourquoi il faut se réapproprier l'histoire de l'Église"). Ce point de vue mériterait débat car il découragerait tous ceux qui font l'effort de s'instruire.
Encore une légère réserve : les exemples choisis portent plus volontiers sur les siècles largement passés mais très peu, ou du moins pas suffisamment, sur l'époque contemporaine ou récente... On peut le regretter.
Encore un mot...
Il y a une expression que Christophe Dickès utilise quasiment dans tous les chapitres : "Contrairement à"... à ce que l'on croit généralement, à ce qui nous a été enseigné, à ce que les anticléricaux veulent faire admettre... Il pourfende les "raccourcis intellectuels", les formules toutes faites, les anachronismes, et là, on ne peut que lui donner raison !
Cet ouvrage offre une vue d'ensemble sur un vaste sujet qui a fait l'objet de nombreuses études souvent hyper spécialisées, peu accessibles, il faut l'avouer, au grand nombre. On peut donc remercier l'auteur d'avoir ici fait l'effort d'une synthèse et "focalisé" son éclairage sur une dizaine de thèmes déterminants.
Christophe Dickès a consulté une abondante documentation et, parmi les auteurs cités, on trouve Marc Bloch dont Apologie pour l’Histoire, métier d’historien est paru chez Dunod poche (janvier 2024) avec une préface de Jacques Le Goff.
Une phrase
"Si les phénomènes de violence qui ont marqué l'Église ponctuellement dans son histoire ont été largement documentés, peu se sont attachés à souligner comment des hommes d' Église se sont aussi distingués par leur capacité à offrir une réflexion sur la guerre et la paix, des origines jusqu'à nos jours... "(P. 153)
L'auteur
Christophe Dickès, docteur en histoire contemporaine, a déjà derrière lui une bibliographie fournie et semble s'être fait une spécialité de l'histoire religieuse, particulièrement chrétienne. Dans la collection "Bouquins", il a dirigé l'ouvrage collectif Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège (2013), L'héritage de Benoît XVI (Tallandier 2017) ainsi que Le Vatican, vérités et légendes (Perrin, 2018). Il a créé "Storiavoce", un podcast dédié à l'histoire (d'abord sur le site de notre partenaire Atlantico) qui offre cours d'histoire et grands entretiens.
Sur notre site, lire la chronique :
Ces dix papes qui ont bouleversé le monde (Tallandier,2015)

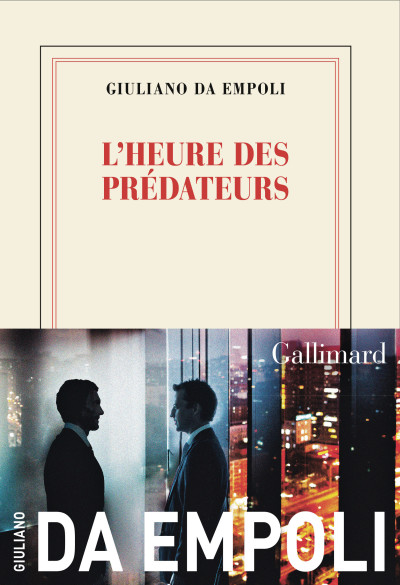
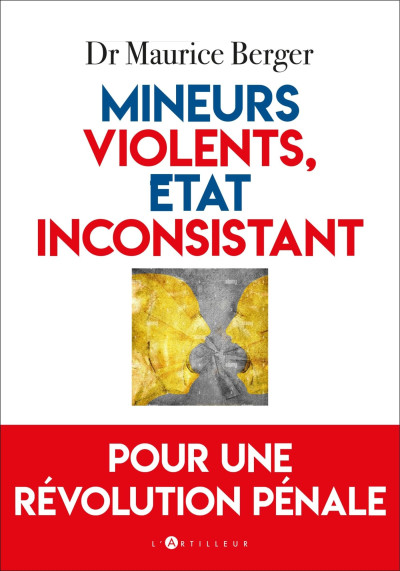
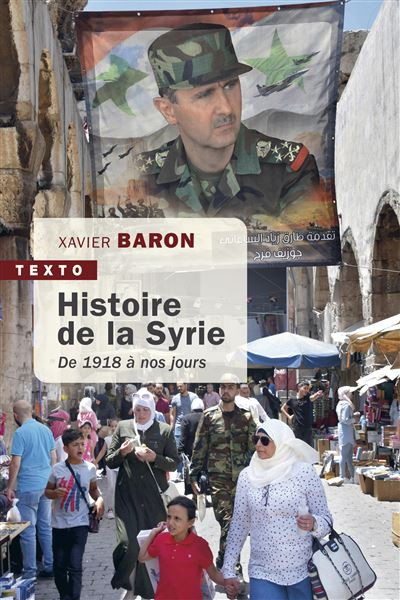
Ajouter un commentaire