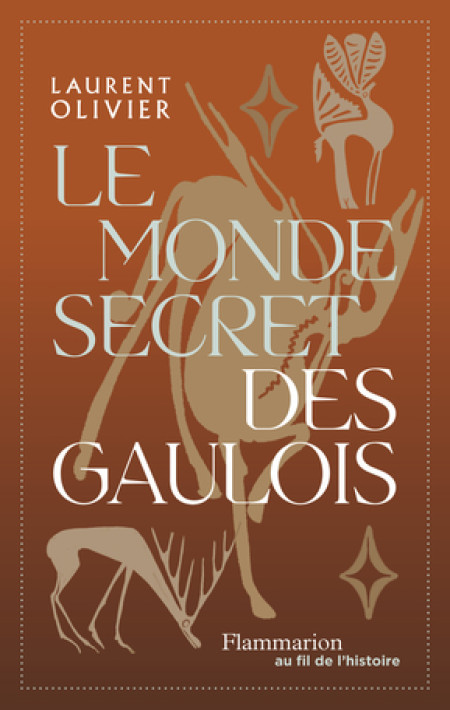
Le monde secret des Gaulois
Parution en octobre 2024
415 pages
23,9 €
Infos & réservation
Thème
A la question "qui étaient les Gaulois", les manuels scolaires ont répondu pendant au moins un siècle, "un peuple barbare, bagarreur, instable", et du bout des lèvres "nos ancêtres". César de son côté, pas vraiment étranger à ce jugement, les décrit dans ses Commentaires, dont La Guerre des Gaules, comme un peuple non civilisé, qui ne connaît pas la loi, indiscipliné, fractionné en d'innombrables petites "nations", bref, ingouvernable. Avant et après lui, géographes, philosophes, voyageurs grecs et romains ont apporté, plutôt plus que moins, leur pierre au mythe de ce peuple incontrôlable, hirsute et sale, dont les modes de vie étaient si éloignés de la Grèce ainsi que de la Rome antique.
Une relecture distanciée des textes, conscient qu'ils ont été écrits par des vainqueurs et des voyageurs qui ne comprenaient pas cette culture, une analyse et un rapprochement des découvertes archéologiques les plus récentes avec les sources littéraires gréco romaines disponibles, dressent un tout autre tableau de la civilisation celte et gauloise. Des bords de la méditerranée à la Grande Bretagne, de la Bretagne continentale à la Belgique et à la rive du Rhin, Ligures, Arvernes, Eduens, Bituriges, Bellovaques, Carnutes, Vénètes, Sénons, Allobroges s'invitent largement dans cet essai pour dessiner, sous la plume de Laurent Olivier, un peuple très fondamentalement différent de l'image d'Epinal des manuels scolaires des années 60. Car ce que veut démontrer cet essai très documenté, c'est que les Gaulois furent un peuple épris de liberté ; si le terme est inadapté pour l'époque, il le fut aussi d'égalité et de démocratie participative. Ce livre s'attache à la redécouverte de la culture gauloise, du VIème siècle avant Jésus Christ jusqu'au second siècle de notre ère.
Petite précision de vocabulaire : Celte est la civilisation qui a occupé l'Europe occidentale les 1000 années avant Jésus Christ. Pour faire simple, les Gaulois furent les Celtes qui vivaient en Gaule (France, Belgique, Italie du nord notamment).
Points forts
S'il fallait en retenir un seul : celui de déconstruire nos stéréotypes sur la Gaule celtique et proposer un panorama très fouillé de ce monde "secret", secret car encore peu révélé, et pas toujours reconnu par les historiens.
En vérité, les points forts sont très nombreux. D'abord, l'essai est très facile à lire, avec des pointes d'humour et des humeurs sans équivoques, quand l'auteur démontre que la conquête romaine, et en particulier la “Guerre des Gaules” de César, fut, manifestement, un abominable génocide. Soucieux de dire sa vérité au Sénat, César construit le mythe du Gaulois "irréductible et sauvage" mais vaincu par la puissance civilisatrice de Rome.
La société Gauloise était - lectures transverses, exégèses de Diodore de Sicile, de Strabon, de Pline, de Suétone, de Tacite…et de César - beaucoup plus structurée et stable que ces auteurs la décrivent. Elle avait cependant le défaut de ne pas reposer sur les mêmes valeurs que Rome, gouvernement des élites, force de la loi, propriété du sol, économie monétaire…
Trop long à détailler, voici un florilège des surprises que réserve cet essai :
- la recomposition de la société celte du VIème siècle à la conquête romaine, histoire dont on comprend l'authenticité tant que Rome n'a pas imprimé sa domination coloniale. Et l'on y apprend que les premiers chefs gaulois aiment l'or et le vin, mais pas la propriété et avaient constituées des royautés, certaines "ostentatoires", reposant sur les liens d'échange et de fidélité, de "dévouement" et la reconnaissance du mérite.
- On y apprend le rôle des druides, qui furent magistrats suprêmes, remparts au pouvoir absolu des rois ou des familles dominantes.
- On y découvre la séparation des pouvoirs dans une société non-étatique, très attachée au libre arbitre et à la légitimité (par les armes, par l'expérience, mais pas par l'argent ou la propriété).
- On découvre ou redécouvre le rôle des femmes dans la société gauloise. Bonemine, femme d'Abraracourcix (les Astérixphiles comprendront) était une femme de caractère, et clairement, Goscinny avait de bonnes sources.
- On y comprend comment l'archéologie vient conforter ou contredire les textes anciens.
- On plonge dans un invraisemblable commerce du vin italien. Pendant plusieurs siècles, des millions d'amphores vendues aux "nations" gauloises, des millions de litres produits transitent à travers la France - pardon, la Gaule, - des cadeaux sont faits aux acheteurs (cratères, vasques et chaudrons), des arnaques sont dissimulées par les vendeurs - l'archéologie, par l'étude comparée des tombes et des matériaux réserve bien des surprises !
- On y découvre le parallèle fait par l'auteur, entre la conquête romaine et la conquête de l'Algérie par la France au XIXème siècle : avec le prisme de la revendication "civilisatrice" du colonisateur, les analogies sont fortes.
- On s'étonne enfin de voir les Iroquois et les Hurons du Canada aux XVII et XVIIIème siècles faire irruption dans cet essai. Ils avaient construit, nous révèle Laurent Olivier, une société très semblable à ce que devait être celle de la Gaule autour des IIème et 1er siècles avant Jésus Christ.
Ouvrage d'historien oblige : l'essai est accompagné de très nombreuses notes, de quelques photos noir et blanc et cartes bienvenues, d'un cahier central en couleur, pour témoigner de la beauté et de l'originalité de l'art celte.
Quelques réserves
Des réserves ? Bonne question !
Disons que la première moitié de l'essai se consacre beaucoup à l'exégèse des textes, avec la lecture moderne de l'âge de fer, du monde antique et celtique. Elle conduit à une description minutieuse de l'organisation sociale, politique et des modes de vie des Gaulois. Passionnante, pleine de surprises, mais cette partie peut paraître longue.
A partir de l'analyse de la guerre totale de César, pointent les déformations de l'histoire officielle, les divergences toujours présentes entre historiens, sur la réalité de la conquête et les apports de la civilisation romaine à la Gaule. C'est d'autant plus passionnant que Laurent Olivier explique bien le poids de la culture classique dans l'interprétation des traces de la civilisation gauloise.
Anecdotique peut-être, quelques commentaires de toute fin semblent plus relever de la conviction politique qu'historique.
Encore un mot...
Cet excellent essai a au moins deux vertus : celle de nous faire découvrir une société mise au banc des civilisations pour non conformité avec le modèle gréco-romain. Il est juste de reconnaître que notre attachement à la pensée, aux institutions, aux valeurs issues de l'Antiquité, nous a fait porter un regard critique et injuste sur la société gauloise.
Sa seconde vertu, outre les connaissances factuelles qu'il apporte, est de nous faire réfléchir sur l'influence de nos représentations culturelles sur la lecture des traces du passé.
S'il ne faut peut être pas idéaliser le modèle tel qu'il est décrit, force est de constater que la Gaule fut décrite barbare car les marques de sa civilisation n'étaient pas celle de la culture gréco-romaine. L'apport civilisationnel des romains fut certainement beaucoup plus celui d'un colonisateur que celui d'un bienfaiteur. Pour autant la restauration de l'identité politique et sociale des Gaulois nous fait comprendre ce que furent - en Europe comme sur le continent américain, du moins compte tenu des sources disponibles - les "démocraties primitives", éprises d'égalité, de liberté, d'indépendance et de délégations légitimes d'autorité. Quelques traits de caractère qui ont traversé les siècles et les générations dans l'hexagone !!
Une phrase
" Comme le disait le grand historien de la Gaule Camille Jullian (1859-1933) [il faut] chercher « l'idée dans la phrase, le sentiment dans le mot ». « Solliciter les textes, disait-il encore, c'est démêler en eux la pensée des âges disparus, trouver en un repli de phrase le mot essentiel, l'idée qui révèle les sentiments des générations mortes, c'est faire parler à travers une parole éteinte." P. 75
"Ce sont bien deux systèmes inconciliables qui s'affrontent, lorsque le monde romain pénètre dans le monde gaulois : deux cultures, deux visions antinomiques de la liberté et de l'individu.
Face à l'autorité, les Gaulois sont attachés à la liberté individuelle : la liberté d'aller et venir, la liberté d'exprimer une opinion personnelle, la liberté de ne pas obéir. Le droit romain de la République est fondé, quant à lui, sur la propriété ; il garantit la souveraineté qu'accorde la possession exclusive des choses et des êtres vivants qui y sont attachés. Le citoyen romain est d'abord un propriétaire - de terres, de troupeaux, d'esclaves. Sa liberté, fixée par la loi, est d'en disposer comme il lui plaît." P. 213"Chez la plupart des historiens, la chute de la Gaule indépendante est généralement considérée comme un événement positif. "On ne saurait mieux dire à quel point l'entreprise de Vercingétorix fut inutile et, si elle avait réussi, à quel point elle aurait privé la Gaule de la chance - car il ne faut pas douter que c'en fut une - de devenir romaine », écrit par exemple aujourd'hui l'historien Paul Martin." P 303
"Le « mythe gallo-romain » est en réalité un modèle colonial qui justifie, au nom du progrès et de la civilisation, la domination et l'exploitation des peuples autochtones. […] En prenant prétexte de l'accession à la civilisation pour justifier la colonisation, ce discours autoritaire - dont le mythe gallo-romain est l'expression - dévalorise ainsi la culture des colonisés, laquelle est destinée à disparaître ou se dissoudre dans celle des colonisateurs." P. 334
L'auteur
Laurent Olivier est Conservateur général du patrimoine, responsable des collections d'archéologie celtique et gauloise, au Musée de Saint Germain en Laye - musée créé par Napoléon III non sans arrières pensées, pour rassembler en un lieu les traces les plus anciennes de l'identité nationale ! Laurent Olivier est archéologue de formation, historien, habilité à diriger des recherches à l'université Paris 1. Il a conduit de nombreuses fouilles archéologiques, tumulus, tombes à char, de l'âge de fer, de l'époque celtique en France. Il a publié et contribué à de nombreux essais sur l'art, la civilisation celte et gauloise, mais aussi sur l'interprétation de ces découvertes selon les époques, et l'influence des idéologies. Une partie de ses travaux récents porte sur les Amérindiens et leur représentation par les Nord-américains.
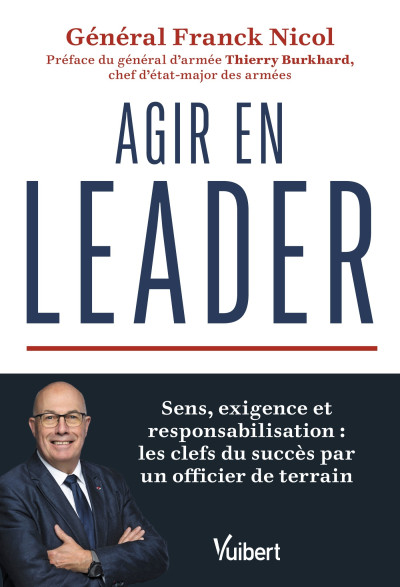
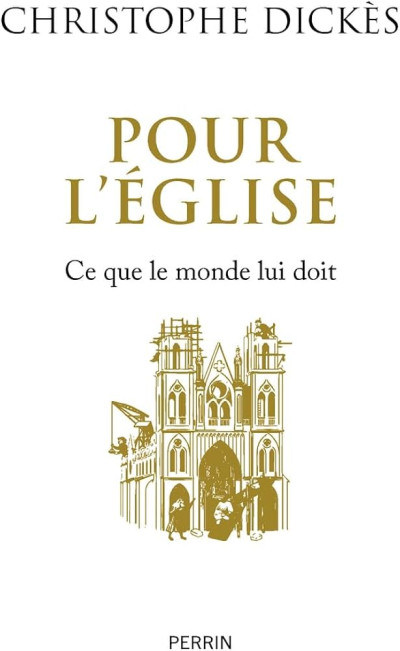
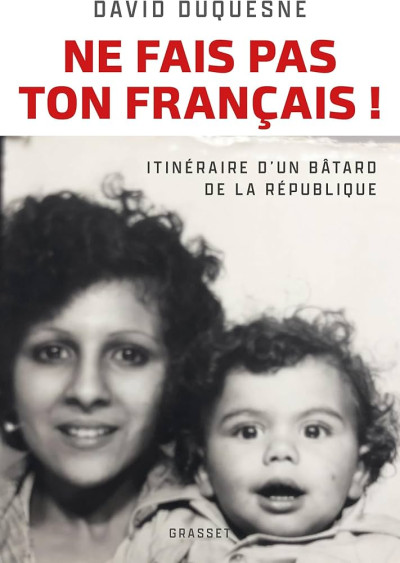
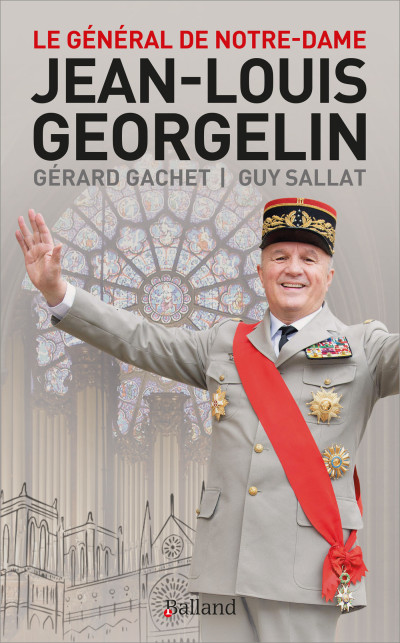
Ajouter un commentaire